DE MEMOIRE (3) LA COURTE SAISON DES GARI
[Révolte 70’s] Extraits du livre de JannMarc Rouillan (Agone 2011)
DE MEMOIRE (3) LA COURTE SAISON DES GARI – TOULOUSE 1974
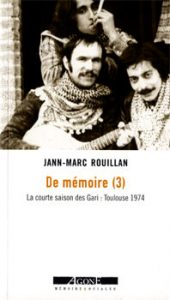 Extrait: « Je n’ai pas dormi. Je profite du voyage entre deux prisons pour me gorger d’images, de couleurs et de visages. Je retrouve le pays de ma jeunesse. Je rentre à Toulouse. Ou plutôt dans sa banlieue. Direction la vieille centrale de Muret. Elle était déjà ouverte en 1974. Souvent, lors de nos sorties furtives en ville, on empruntait la route de Seysses, pour éviter les contrôles et les barrages de police au carrefour du Fer à Cheval ou à la Croix de pierre et plus loin à la hauteur de l’ONIA sur la route d’Espagne. (…) Dans la Ford Focus, deux matons somnolent. Et un autre téléphone à sa femme toutes les demi-heures. le chauffeur pousse le volume de la radio sur un vieux Beatles: « comme together, right now…over me » pour le principe, une simple paire de menottes lie mes poignets. Ni chaînes ni entraves. Ni escorte de police. Après vingt-cinq ans de zonzon, je suis transporté comme un voleur de poules ! On dépasse l’aire de repos du Lauragais. les gendarmes y ont abattu un poto. En quelle année? Je ne sais plus. On l’appelait Dudu et il avait attaqué un transport de fonds rue de la Colombette. Blessé dans la fusillade puis capturé: vingt ans de gamelle pour notre Dudu! Puis une permission à muret, une cavale…et la mort quelques jours plus tard. »
Extrait: « Je n’ai pas dormi. Je profite du voyage entre deux prisons pour me gorger d’images, de couleurs et de visages. Je retrouve le pays de ma jeunesse. Je rentre à Toulouse. Ou plutôt dans sa banlieue. Direction la vieille centrale de Muret. Elle était déjà ouverte en 1974. Souvent, lors de nos sorties furtives en ville, on empruntait la route de Seysses, pour éviter les contrôles et les barrages de police au carrefour du Fer à Cheval ou à la Croix de pierre et plus loin à la hauteur de l’ONIA sur la route d’Espagne. (…) Dans la Ford Focus, deux matons somnolent. Et un autre téléphone à sa femme toutes les demi-heures. le chauffeur pousse le volume de la radio sur un vieux Beatles: « comme together, right now…over me » pour le principe, une simple paire de menottes lie mes poignets. Ni chaînes ni entraves. Ni escorte de police. Après vingt-cinq ans de zonzon, je suis transporté comme un voleur de poules ! On dépasse l’aire de repos du Lauragais. les gendarmes y ont abattu un poto. En quelle année? Je ne sais plus. On l’appelait Dudu et il avait attaqué un transport de fonds rue de la Colombette. Blessé dans la fusillade puis capturé: vingt ans de gamelle pour notre Dudu! Puis une permission à muret, une cavale…et la mort quelques jours plus tard. »
Extrait: « Parfois on utilisait le bar des Beaux Arts. On ne craignait pas qu’il soit surveillé. De ce temps, les flics en savaient assez sur le mouvement révolutionnaire pour être certains qu’ils n’avaient rien à craindre des situationnistes. Et j’aimais surprendre leurs binettes quand ils nous reconnaissaient. Ils enrageaient de haine et de trouille. Une fin d’après midi, Ratapignade précédait notre petit groupe. Il a traversé la salle jusqu’au recoin où se tenait une tablée de crypto-situs. Pour la plupart, nous les connaissions. Le fils d’un notaire tarnais, le fils du professeur machin chose, universitaire et membre du PCF, l’héritière déglinguée d’une entreprise de livraison dont les camions sillonnaient la ville. Enfin des radicaux « pour de vrai » capables de vous révéler le moindre détail de la « véritable » radicalité. Ils dégoisaient de grandes vérités mais tous leurs discours sonnaient faux. Et bancals. L’absence de pratique d’un antagonisme transgressif vide de leur substance subversive chaque mot comme chaque phrase. Nos attentats, aussi modestes et limités qu’ils furent, creusaient un fossé avec les postures des sacristains du protestataire et des clercs des hautes solitudes théoriques. (…) Nos situs, pareils à leurs maîtres à penser parisiens, nous dénonçaient comme « agent des préfectures ». Nous aurions été les prétextes à la répression des vrais révolutionnaires et des radicaux. Et comme la compagnie des procureurs légalistes du groupuscule pépère, ils nous mettaient sur le dos le vote des lois d’exception. La salle était bondée et nous étions condamnés à nous asseoir à leurs côtés. Il a suffit de la réflexion d’un de nos voisins ou de la moue d’unes des amies de sa sœur…Et Ratapignade s’est tourné vers eux en lançant avec emphase:
– Bonjour mes seigneuries! »
Extrait: « Il n’avait pas besoin de nous le demander. On enregistrait chaque mot et même leurs silences. On considérait comme un indicible honneur qu’ils soient sortis des livres d’histoire pour partager leurs expériences avec nos. Ils avaient connu des défaites désespérantes et des victoires enivrantes, des batailles épiques et la torpeur des jours sans combat. Ils se foutaient pas mal des carcans idéologiques et des principes de Bisounours, des belles phrases et des « coordinations libertaires de groupes et d’individus ». Ils n’étaient pas sectaires. D’ailleurs, ils parlaient d’un « Nous » extrêmement large sans jamais dire à quelle organisation ils appartenaient. La GAI peut être ? Les Jeunesses? Ils savaient que là n’était pas l’important tout en tenant à leur organisation plus qu’à la prunelle de leurs yeux. Leur « Nous » rappelait le « Nosotros » de Durruti, Ascaso et les vieux de l’action armée. Pourquoi étaient ils en face de nous cette après midi de novembre? Bien sûr, la solidarité avec le MIL prenait une ampleur inattendue, surtout à Barcelone où une partie de la jeunesse réagissait. Mais il y avait autre chose, je le pense avec le recul de l’histoire. Nous étions précédés par une réputation de violence héritée des bagarres toulousaines de l’après 1968 et alourdies à cette heure par l’usage des armes et des explosifs… Comme toutes les réputations, elle était largement surfaite! Enfin… pour notre part, nous nous considérions comme des garçons tout à fait sympathiques et fréquentables! »
Extrait: « Quelques jours en arrière, on avait eu une longue discussion avec Marie Lafranque en compagnie d’un vieil Espagnol théoricien des milieux anarchistes traditionnels et pacifistes. Même les indécrottables partisans de la lutte armée parlaient de lui avec un infini respect. Marie, que nous croisions depuis 1968 de réunion en mobilisation, était plus âgée que nous. Elle était victime d’un handicap hérité de la poliomyélite. (…) Le contact direct avec Marie avait été établi par la tante d’Oriol Sole Sugranez, une religieuse réfugiée à Toulouse. De ce temps, il y avait encore des prêtres ouvriers et cette petite bonne femme énergique se revendiquait « nonne ouvrière »…et anarchiste! Lors des réunions, les vieux rouges l’observaient avec circonspection. Ils ne comprenaient pas comment ils étaient tombés si bas qu’ils toléraient une bonne sœur à leurs commémorations. (…) Il n’y avait pas à tourner autour du pot. Ils savaient ou se doutaient. Quoi qu’il en soit, ils voulaient en parler avec nous. Avec lenteur, l’homme parla le premier.
– Lé plous pacifique des anarchistes né mettra jamais en rapport la biolence des oppresseurs et la biolence des opprimés. Elles sont absolument distinctes. Ainsi yé n’ai pas le droit…yé ne me sens pas inbesti de l’autorité des principes pour condamner botre biolence…Sauf, yustement, si vous dépassez les principes.
Marie acquiesça.
– Les hold-up, on peut les comprendre si vous n’usez pas de violences sur les employés. Les bombes également, si vous ne tuez pas des innocents.
– Mêmé la mort dés policiers au cours dés fusillades, nous l’admettons, reprit l’homme. Mais si vous enlebez un hommé, il débient botre prisonnier. Bous né débez pas user de biolence contre lui. Et ça c’est un principe! Si bous lui faites subir des mauvais traitements, bous debenez aussi ignobles que les gens que bous combattez. Tortionnaires comme des franquistes! Bous debenez aussi maubais qu’un yuge, qu’un policier, qu’un gardien dé prison.
A nos têtes, ils comprirent qu’ils marquaient des points. De toute manière, il est certain qu’aucun d’entre nous n’avait l’âme d’un tortionnaire. »
Extrait: « On n’était ni des saints ni les culs-bénis d’un quelconque ordre nouveau, on était pleinement les enfants d’une épopée de liberté. On ne supportait ni les interdits ni les propagandes étatiques religieuses, morales et politiques. Ainsi on était tout naturellement attirés par les différents produits de notre ami le dealer. La drogue ne nous effrayait pas. La dope ! comme nous l’appelions. On se savait plus forts qu’elle. On n’était en rien de la chair à accoutumance, ni pour le travail salarié, ni pour les habitudes métro-boulot-dodo, ni pour le train-train des fausses révoltes et des fausses communautés…Pour rien au monde on n’aurait enchristé notre liberté. Une ou deux fois par semaine, on bouclait les appartements clandestins et on retrouvait la faune excentrique du Milkyway. On testait les produits illicites installés sur les coussins de la grande salle des concerts électriques. De mon côté je préférais m’allonger au quatrième étage sur les larges gradins du cinéma où l’on projetait des films underground. On ne risquait pas une descente des flics. Ni une embrouille près d’une de nos planques. La musique nous emportait. Et on vibrait des nuits entières au rythme des tam-tam psychédéliques et des poudres de perlinpinpin. »
Extrait: « Dans la cité du Mirail, certains soirs on descendait prendre l’apéro ou manger chez des cadres des organisations gauchistes, nos voisins. On prolongeait tard le soir nos discussions enflammées sur la solidarité avec la révolution portugaise et la résistance antifranquiste. On se chamaillait à propos de l’usage de la lutte armée et de la construction des nouveaux partis. Ainsi on n’hésitait pas à passer trois étages plus bas chez le grand chef local de l’Organisation communiste des travailleurs, un ancien copain du lycée Fermat ayant dirigé les comités d’action lycéens entre 1968 et 1970. On se remémorait les bastons et les crêpages de chignon. Il avait fait quelques jours de prison lors d’une de nos aventures. Invariablement, il essayait de nous tirer les vers du nez à propos des nombreux braquages dans la ville et sa périphérie. On niait mais il n’était pas dupe et il nous grondait comme s’il avait été notre aîné. On restait tard même s’il travaillait tôt le lendemain. Chez lui et dans de nombreux apparts des copains, on fit la connaissance des femmes légitimes, des compagnes et des maîtresses…et des premiers enfants, des nourrissons brailleurs et des petites filles aux tresses sombres. Le look de ces pères de famille s’était assagi. Déjà un ventre rondelet tirait les mailles du chandail. La barbe était moins drue. Les cheveux plus courts. Ça sentait moins la fumée du bon shit et davantage la blanquette de veau. Parfois on était invité à un anniversaire. A une de ces fêtes sur commande rythmant le bonheur simple. Et invariablement on se soumettait au même rituel à l’arrivée. Avant toute embrassade, on se dirigeait directement vers la salle de bain et le copain recueillait nos pistolets dans un sac. »
Extrait: « Le lendemain on a rencontré les camarades espagnols dans un pavillon près de la cité universitaire d’Antony. Ils nous apportèrent deux textes signés Gari dont ils n’étaient pas contents et voulaient discuter. Ils furent surpris qu’on ne sache rien de ces textes. Et plus encore qu’on ignore qui avait bien pu écrire de telles conneries anarcho-existentialistes. D’ailleurs, nous, ex-MIL, n’avons jamais participé ni de près ni de loin à l’écriture d’un seul texte signé Gari. Jamais. Et avec le recul j’en suis encore étonné. Quand à Marseille, plus de trente ans après, je montrai mes archives Gari à Ratapignade, on était arrivés à la même conclusion. Sans qu’on y prenne garde, on avait laissé s’installer une division des tâches entre ceux qui exécutaient les actions et ceux qui tartinaient de la petite idéologie de bazar. Ces choses sont insidieuses. Elles se font presque naturellement en l’absence de corrections politiques et de débats internes. Et ce genre de déviations politique est souvent le fait de camarades qui se prétendent les plus anti-autoritaires du monde et les plus convaincus de l’inutilité d’une organisation. »
Extrait: « Depuis des jours, on attendait la confirmation de la mort de Franco. Deux fois déjà, elle avait été démentie. Enfin, la larme à l’œil, Arias Navarro, le Premier Ministre du bunker, avait annoncée la disparition du tyran. (…) Le lendemain matin quand on s’est rejoints dans la salle commune, avec quelques tapes amicales, on était plus émus que joyeux. Oui, un indicible sentiment nous avait submergés. Mario baissa la tête en s’asseyant à la grande table blanche. En vain, Ratapignade tenta de blaguer puis fit bouillir de l’eau sur la chauffe artisanale. On resta silencieux un long moment. Comme si on se réveillait d’un rêve lourd et menaçant. Et les mots franchirent difficilement mes lèvres. J’ai parlé de la période de lutte à Barcelone. Des camarades. Ceux qui étaient morts et ceux qui préparaient leur paquetage dans les penales. L’exil qui prendrait bientôt fin pour eux comme pour nous. Maintenant on avait besoin d’évoquer tous les autres et avant tout nos devanciers, tous les companeros depuis le premier jour, ce fameux 19 juillet 1936, depuis la mort d’Ascaso, tombé au cours de l’assaut de la caserne de Las Atarazanas, ceux del frente de Aragon, des barricades de mayo 19367, de la Retirada, les guérilléros des différents maquis, les garrotés, les fusillés…les morts de tuberculose au penal d’Ocana, les torturés des cachots de Puerta del Sol et de Via Layetana…Et bien qu’on ne soit pas particulièrement pratiquants de ce genre de cérémonie militante, on s’est lentement redressés et on a levé le poing serré. La tête basse. Sans un mot. Sans un chant. Une solennité simplement pour nous. Entre nous. Intime d’un même souffle. Au plus profond d’un cachot parisien à mille kilomètres de la frontière. On marquait l’instant d’une pierre blanche. La guerre d’Espagne avait pris fin et nous l’avions définitivement perdue. Nos drapeaux, ceux des rouges et les autres, quelles que soient leurs couleurs, étaient à terre. La trahison se trouvait partout glorifiée. »